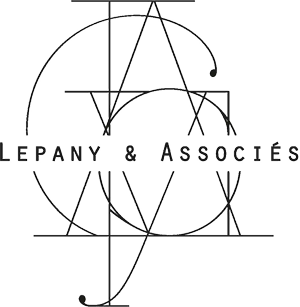La loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025, publiée le 2 mai 2025, est venue substantiellement modifier l’action de groupe des organisations syndicales représentatives.
En effet, si l’action de groupe des organisations syndicales représentatives a, été instituée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, elle ne bénéficiait alors que d’un champ excessivement restreint pour ne concerner que les questions de discrimination des candidats et des salariés et de respect des données personnelles.
C’est ainsi que de seulement trois contentieux ont été, à notre connaissance, initiés par des organisations syndicales.
Outre leur faible nombre, il faute noter, qu’à ce jour aucune de ces actions n’ont abouti à des décisions statuant sur le fond (CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 mars 2024, n° n° 21/07005 ; CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 mai 2024, n° 23/16079).
Parallèlement, il est à constater que les actions engagées par les syndicats au titre de la défense des intérêts collectif de la profession sur le fondement l’article L. 2123-3 du Code du travail ont vu leur recevabilité mise à mal par la Cour de cassation.
En effet, cette dernière est venue considérer qu’une organisation syndicale ne pouvait solliciter le rétablissement dans leurs droits des salariés, sauf à faire cesser une situation illicite ou à enjoindre l’employeur de se conformer, pour l’avenir, à une règle sociale (Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-17.782 ; Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 22-21.966 et n° 22-17.106 ; Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-14.807).
Il y avait donc urgence à repenser les contours de l’action de groupe pour donner aux organisations syndicales les moyens judiciaires d’agir.
Reste à savoir si la nouvelle action de groupe va permettre de répondre aux attentes des organisations syndicales à ce titre.
I – Quelles sont les organisations syndicales pouvant introduire une action de groupe ?
L’action de groupe n’échappe pas au principe énoncé à l’article 31 du Code de procédure civile selon lequel seules peuvent intenter une action les personnes “qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention”.
En ce sens, le législateur avait, dès l’introduction de l’action de groupe dans le Code du travail via la loi de modernisation de la justice de 2016, entendu restreindre le champ des personnes pouvant agir en justice.
L’article L. 1134-7 du Code du travail prévoyait donc que ne pouvaient donc ester en justice que :
- les organisations syndicales représentatives ;
- les association déclarée depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
Sur ce point, la loi du 30 avril 2025 reprend à l’identique les dispositions antérieures en énonçant que l’action de groupe peut être exercée par « les organisations syndicales représentatives ».
Ainsi, les organisations syndicales non représentatives ne peuvent pas agir dans le cadre d’une action de groupe.
Le texte prévoit également, à l’instar des articles L. 77-11-1 et suivants du Code de justice administrative, que peuvent agir devant le juge administratif les organisations syndicales représentatives :
- dans la fonction publique ;
- des magistrats de l’ordre judiciaire.
Parallèlement, le législateur est également venu prévenir toutes éventuelles situations de conflit d’intérêts, en enjoignant sommairement ces derniers à “ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts ».
Enfin, si le Code du travail était silencieux sur ce sujet, les organisations syndicales représentatives se voient désormais obligées de prendre toutes les mesures nécessaires à la parfaite information du public de l’introduction, l’état d’avancement et des décisions relatives à ces actions.
Il convient néanmoins de préciser que le législateur n’a, pour l’heure, pas prévu de disposition venant sanctionner le manquement à cette nouvelle obligation.
II – Quel est le champ de l’action de groupe exercée par les organisations syndicales représentatives ?
Antérieurement, le champ d’intervention des organisations syndicales, particulièrement restreint, ne concernait que :
- l’établissement du fait que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés faisaient l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un motif prohibé et imputable à un même employeur,
- la cessation des manquements de l’employeur aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la réparation du préjudice subi.
La nouvelle Loi élargit le champ d’intervention de l’action de groupe en précisant que les organisations syndicales représentatives pourront désormais intenter une telle action :
- en matière de lutte contre les discriminations ;
- en matière de protection des données personnelles ;
- lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
Ainsi, l’action de groupe pourra être mobilisée par les organisations syndicales représentatives en présence de manquements commis par l’employeur, notamment, s’agissant du non-respect d’accord collectif ou des dispositions légales ou règlementaires sous réserve que cela concerne bien plusieurs personnes.
Il est à noter que la loi DDADUE de 2025 introduit également une action de groupe transfrontalières, soit une action introduite devant une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ouverte aux demandeurs ayant reçu un agrément de l’administration dans des conditions et délais qui restent à définir par décret.
III – Quelle procédure à respecter ?
Reprenant le dispositif existant, la loi du 30 avril 2025 vient prévoir que, préalablement à toute action de groupe, toute organisation syndicale représentative :
« demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué. »
A compter de la réception de cette demande, l’employeur doit alors en informer, s’il existe, le comité social et économique et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans un délai d’un mois.
Dès lors que le CSE ou une organisation syndicale représentative se saisit de cette faculté, l’employeur aura alors une obligation positive d’engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée.
Ce n’est alors qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification, tout à fait hypothétique, par l’employeur du rejet de la demande, que l’action de groupe pourra être engagée.
Ce délai de six mois peut apparaitre particulièrement long surtout en cas d’inaction de l’employeur.
IV – Les demandes pouvant être portées lors de l’action de groupe d’une organisation syndicale représentative
Loi du 30 avril 2025 précise les prérogatives du juge saisi d’un manquement de l’employeur à la législation du travail, distinguant entre la réparation du préjudice (A.) et la cessation du manquement (B.).
A. La cessation du manquement prononcée par le juge
Lorsque l’action de groupe tend à faire prononcer la cessation du manquement, il n’est alors aucunement question pour l’organisation syndicale représentative d’établir un préjudice pour les candidats ou salariés du groupe, ni de rapporter la preuve de l’intention ou de la négligence de l’employeur.
La loi d’avril 2025 est venue prévoir une série de mesures pouvant être ordonnées par le juge afin de contraindre l’employeur à faire cesser ledit manquement, à savoir :
- une astreinte liquidée au profit d’un fonds consacré au financement des actions de groupe ;
- des mesures provisoires ;
- des mesures de publicité pour informer de cette décision les candidats et salariés susceptibles d’être concernés par les manquements constatés.
B. La réparation du préjudice subi
Parallèlement, l’action de groupe peut avoir comme motivation la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice subi par les candidats et salariés du groupe pris individuellement.
Ainsi, la loi du 25 avril 2025 précise qu’il appartient au juge de définir le groupe de personnes à l’égard duquel la responsabilité de l’employeur est engagée et ce, en précisant les critères de rattachement au groupe.
Exemple : En cas d’action de groupe visant à faire reconnaître le préjudice subi par les salariées d’une même entreprise en raison des discriminations subies du fait de leur sexe, le juge pourra fixer comme critère de rattachement au groupe le statut de salarié et leur genre.
Une fois la responsabilité de l’employeur reconnue, le juge doit déterminer les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Au-delà de la simple évaluation du préjudice et de sa répartition au sein du groupe, le juge pourra :
- ordonner les mesures de publicité adaptées pour informer de sa décision reconnaissant la responsabilité de l’employeur les salariés et candidats susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le manquement constaté ;
- fixer le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice ;
- décider de la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices et, pour ce faire, peut habiliter l’organisation syndicale représentative à négocier, avec l’employeur, l’indemnisation des préjudices subis par chacun des salariés constituant le groupe dans un délai ne pouvant être inférieur à six mois tout en gardant la faculté de refuser l’homologation de l’éventuel accord si les intérêts des parties et des salariés lui paraissent insuffisamment préservés;
- ordonner, lorsqu’il est saisi d’une question intéressant la responsabilité de l’employeur, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par ce dernier.
En sus des décisions précédemment listées, le juge doit fixer deux délais :
- Celui laissé à l’employeur condamné pour procéder à l’indemnisation ;
- Celui, qui débutera à l’expiration du premier, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles il n’a pas fait droit.
Parmi les grandes nouveautés de la loi du 30 avril 2025, le législateur est venu instituer un nouvel article 1254 du Code civil, lequel prévoit qu’en cas de faute délibérée de l’employeur à ses obligations, le juge peut, à la demande du ministère public, condamner ce dernier au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe.
Deux conditions doivent alors être concomitamment réunies :
- l’employeur doit avoir délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
- son manquement constaté doit avoir causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
Il convient néanmoins de préciser que les dispositions de ce nouvel article 1254 du Code civil ne sont applicables qu’aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.
V – L’adhésion au groupe postérieurement au prononcé du jugement
Une fois le jugement prononcé, les salariés bénéficieront alors d’un délai, fixé par le juge, pour adhérer au groupe en adressant une demande de réparation à l’employeur ou directement à l’organisation syndicale représentative à l’origine de l’action.
Cela délai ne saurait être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.
Il convient néanmoins de bien garder en tête que la participation à l’action de groupe ne vaut pas, de fait, adhésion à l’organisation syndicale demanderesse.
D’ailleurs, les candidats et salariés dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge afin de demander la réparation de leur préjudice individuel et ce, dans les conditions et limites qui devront être fixées par le jugement sur la responsabilité de l’employeur.
Le mandat donné aux associations et organisations syndicales représentative vaut néanmoins pour :
- L’action aux fins d’indemnisation ;
- L’exercice de l’action en justice visant à faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé
VI. La suspension de la prescription par l’action de groupe
Qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
Le délai de prescription recommence alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
Il convient d’ailleurs de bien noter que la loi du 30 avril 2025 précise expressément que l’adhésion du salarié ou du candidat au groupe ne fait aucunement obstacle à son droit d’agir devant le Conseil de prud’hommes pour obtenir la réparation de son préjudice ne relevant pas du champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ de l’accord homologué.
 01 44 63 73 41
01 44 63 73 41